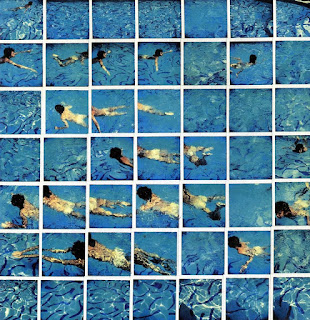Cliquez sur l'image pour l'agrandir
|
kART d'identité
Œuvre : La Chambre de Van Gogh à Arles
Artiste : Vincent Van Gogh 
Année : 1888
Technique : Huile sur toile
Epoque : Contemporaine
Mouvement : Post impressionnisme
Lieu : Musée Van Gogh (Amsterdam)
|
En savoir +
Voici l'une des œuvres les plus célèbres du peintre postimpressionniste
Vincent Van Gogh. Ce peintre aux multiples vies, a beaucoup voyagé. Le 20 février 1888, il quitte Paris attiré par l'exotisme et le soleil méditerranéen déjà mis en peinture par Paul Gauguin. Il s'installe à
Arles où il y découvre la lumière provençale. Il parcourt alors la région et peint des paysages, des scènes de moissons et des portraits. Il envoie ensuite ses tableaux à son
frère Théo à Paris pour les exposer ou les vendre.
 |
| Vincent Van Gogh "La maison jaune" (1888) |
Le 17 septembre 1888, il s’installe en centre-ville dans la «
maison jaune » où il installe également son atelier. Bien qu’il apprécie Arles, Van Gogh aime vivre au sein d’autres artistes, à la manière du
quartier Montmartre à Paris, où il vivait quelques mois auparavant. Il fait alors appel à
Paul Gauguin et l’invite à le rejoindre dans le but de reconstituer une
communauté d'artistes unissant fraternellement leurs expériences et leurs recherches.
En attendant Gauguin, en route pour le rejoindre, Van Gogh va peindre sa
Chambre à coucher dans la « maison jaune ».
 |
Vincent Van Gogh
"Paul-Eugène Milliet" (1888) |
 |
Vincent Van Gogh
"Eugène Boch" (1888) |
Cette chambre est toute simple et bien rangée. C’est la première fois qu’il dispose d’un endroit à lui (auparavant il a surtout vécu dans des auberges) et il est décidé à prendre soin de lui. Van Gogh n’est pas un peintre reconnu et n’a pas beaucoup d’argent. Son frère Théo lui envoie d’ailleurs régulièrement de l’argent. Les
meubles sont donc sobres, il ne possède que le strict minimum : un lit, deux chaises, une table avec une cuvette et une cruche d’eau pour la toilette, une serviette suspendue à un clou, à côté d’un miroir. Les
tableaux accrochés aux murs sont de lui : un paysage sur le mur du fond, deux portraits (le portrait du peintre Eugène Boch et le portrait de Paul-Eugène Milliet.) et deux dessins sur papier.
Le meuble qui domine le tableau est
le lit. Il parait grand et douillet. Il symbolise la chaleur et le confort. Tous les autres meubles paraissent plus petits, et sont représentés
par paire. Certains suggèrent que ces paires montrent la volonté du peintre de ne plus être seul.
La maison jaune était une bâtisse assez ancienne. Son
architecture irrégulière lui donnait un aspect « tordu ». Cela transparaît dans ce tableau. Les murs des côtés se rapprochent beaucoup vers le fond, ce qui donne une impression de
profondeur exagérée à la pièce et en particulier au lit, qui paraît énorme.
Dans une lettre qu’il adresse à son frère, Van Gogh explique qu’il voulait exprimer la
tranquillité à travers la
simplicité de la chambre mais aussi au
choix des couleurs :
"les murs lilas pâle, le sol d'un rouge rompu et fané, les chaises et lit jaune de chrome, les oreillers et le drap citron vert très pâle, la couverture rouge sang, la table à toilette orangée, la cuvette bleue, la fenêtre verte", affirmant :
"J'avais voulu exprimer un repos absolu par tous ces tons divers".
Mais cette tranquillité ne sera que de courte durée. Quelques jours après, Gauguin arrive à Arles. Mais les deux hommes s'entendent mal : la tension entre les deux hommes débouche sur une
violente dispute en décembre 1888 durant laquelle, Van Gogh, en proie au délire, tente de tuer son compagnon, puis, pour s’auto-punir, se mutile l'oreille, ce qui donnera naissance à un autre de ses tableaux célèbres.
Ce tableau a été abîmé par une inondation. Avant qu’il ne soit restauré, Van Gogh en réalisera une autre copie l’année suivante à la demande de son frère puis une troisième copie qu’il offrira à sa sœur. Les
deux autres versions ne sont pas identiques. Les couleurs varient, les portraits cloués au mur sont différents par exemple.
 |
La Chambre à coucher (deuxième version)
septembre 1889 - (Institut d'art de Chicago, Chicago) |
|
 |
La Chambre à coucher (troisième version)
septembre 1889 - (Musée d'Orsay, Paris) |
|
Quant à la Maison jaune rendue célèbre par le peintre, elle fut bombardée durant la Seconde Guerre Mondiale. Elle n’existe désormais qu’à travers les tableaux du peintre.
Téléchargez et imprimez la fiche repère :




 n°223
n°223