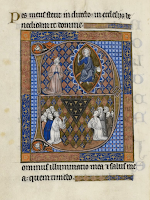En savoir +
A la fin du XVème siècle, l’art vit une véritable révolution venant d’Italie : la Renaissance. Ce tableau de Domenico Ghirlandaio est un des témoins de ce renouveau. Ce portrait est sans doute son œuvre la plus connue notamment à cause du traitement très réaliste (et très novateur pour l'époque) des deux personnages.
A gauche, un vieil homme vêtu d’un pourpoint rouge et d’un cappuccio posé sur son épaule est assis. Il tient dans ses bras un jeune garçon également vêtu de rouge et d’une toque.
Le vieil homme regarde tendrement le jeune garçon, son sourire témoigne d’une grande bonté et entoure de son bras le corps du jeune garçon. Les deux personnages sont vêtus de manière assez luxueuse pour l’époque, signes qu’ils sont tous deux issus d’une famille florentine assez aisée. Ils sont assis dans un intérieur, éclairés contre un mur noirci. Derrière eux, à droite, une ouverture découvre un paysage aux routes sinueuses. En effet, les portraits d’intérieur avec une vue sur l’extérieur étaient très à la mode en Italie.
Une des caractéristiques, assez visible, du visage de l’homme est son nez déformé par le rhinophyma, une maladie assez courante, souvent liée à l’excès d’alcool. A cela s’ajoute une verrue sur son front. Cela créé un apparent contraste entre les deux personnages : d’une part la vieillesse et la laideur et d’autre part la jeunesse et la beauté.
Pourtant, en peignant ces difformités, le peintre souhaite mettre en valeur l’attitude de l’homme et sa douceur, plutôt que sa beauté physique. L’accent est mis sur son sourire, son regard rassurant et bienveillant envers le jeune garçon. Ce dernier ne ressent d’ailleurs aucun dégoût face à la laideur du vieil homme. Au contraire, il lui répond avec sa main délicatement posée sur le vieillard. Les deux personnages se regardent avec tendresse et affection : c’est une vraie relation de confiance qui unit ces deux personnages finalement assez semblables. L’artiste nous rappelle ainsi que l’amour va bien au-delà de la beauté physique, que l’essentiel se passe dans le cœur de chacun.

On ne connait pas l’origine de l’œuvre, ni l’identité, ni même le lien entre les deux personnages. Certains y voient un grand-père et son petit-fils mais aucun élément nous permet de l’affirmer.
Il semblerait que la toile ait été peinte après le décès du vieillard puisqu’un dessin de Ghirlandaio a été retrouvé, représentant ce même vieillard les yeux fermés, sans doute sur son lit de mort. Le tableau aurait pu être une commande d'un des descendants du défunt, un portrait sur panneau de bois qui aurait une fonction commémorative.
Télécharger et imprimez la fiche repère :


 n°327
n°327