
En savoir +
Haut de plus de 6 mètres et large près de 10 mètres, ce tableau majestueux est le deuxième plus grand tableau du musée du Louvre. Achevé en 1807, il a fallu au peintre Jacques-Louis David plus de deux ans de travail.
Jacques-Louis David vient d’être nommé peintre officiel de l’empereur Napoléon Ier. Aussitôt, celui-ci commande au peintre quatre tableaux représentant quatre grandes étapes de la cérémonie de son propre sacre survenu la même année. A la clé, il promet au peintre un salaire mirobolant de 100 000 francs par tableau.
L’œuvre est monumentale, près de 200 personnes sont représentées, toutes le regard pointé sur l’Empereur debout en plein centre. Son épouse Joséphine, agenouillée, s’apprête à recevoir sa couronne.
Nous sommes le 2 décembre 1804, le jour du sacre de Napoléon Ier. Autour du couple, six groupes de personnes sont méticuleusement répartis. On trouve :
- Les membres de la famille de Napoléon et de Joséphine
- Les représentants de l’Etat français, notamment les ministres
- Le corps diplomatique c’est-à-dire les représentants des Etats alliés de Napoléon
- Les représentants de l’armée impériale
- Les représentants du clergé dont le pape
- Les spectateurs
On peut aussi observer la présence des régalia, ces objets symbolisant le pouvoir de l’empereur :
- la couronne de laurier, symbole du pouvoir impérial, sur la tête de l’empereur (A)
- la couronne de l’Impératrice (B)
- le sceptre surmonté de l’Aigle (C)
- la main de justice (D)
- l’orbe (globe terrestre surmonté d’une croix) (E)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
L’œuvre montre en fait le moment qui suivit : Napoléon sacre ensuite lui-même sa femme Joséphine qui, en recevant la couronne de son époux, devient impératrice des Français pendant que le pape assis à droite, impuissant, dépité et se sentant peut être un peu inutile, tend la main en signe de bénédiction.
Le titre du tableau est donc trompeur car il ne correspond pas à la scène ; en effet, on assiste non pas au couronnement de Napoléon mais de celui de sa femme Joséphine. En fait, à l’origine, la première version du tableau aurait dû représenter l'empereur se couronnant lui-même ; mais Napoléon refusa l’idée, pensant qu’elle était peut-être un peu trop autoritaire (nous ne sommes que quelques années après la Révolution)
Le tableau est un vrai témoignage de ce sacre historique. Le peintre David était d’ailleurs lui-même présent parmi les spectateurs pour reproduire le plus fidèlement possible l’évènement. Il doit représenter les 191 personnes présentes dans la cathédrale; pour cela, il fait de nombreuses études croquées et prend de nombreuses notes afin de n'oublier aucun détail. Dans son atelier aménagé à cet effet, David fait poser la plupart des participants. Il y recompose la scène à l’aide de maquettes en carton et de figurines en cire. Le peintre peut ainsi présenter une œuvre très proche de la réalité surtout dans la réalisation des portraits tout à fait reconnaissables.
Toutefois, le peintre s’arrange parfois avec la réalité historique en représentant par exemple la mère de l’empereur alors que celle-ci était absente le jour du sacre. L’œuvre sert surtout d’outil de propagande : Napoléon souhaite par cette œuvre se montrer comme un homme de pouvoir qui unifie la France.
Le tableau achevé, l'empereur se serait exclamé : "Que c'est grand ! Que c'est beau ! Quel relief ont tous ces ornements ! Quelle vérité ! Ce n'est pas une peinture. On vit, on marche, on parle dans ce tableau!" La toile fut présentée au public au Salon de peinture annuel de 1808.
Sur la commande de l'empereur, le peintre n'aura finalement réalisé que deux des quatre tableaux prévus. En effet, le peintre n'a tout simplement pas été payé la somme convenue par l'Empereur ! Le tableau resta la propriété du peintre jusqu'en 1819 !
Télécharger et imprimez la fiche repère :

Téléchargez l'image "qui est qui" en HD

 n°301
n°301






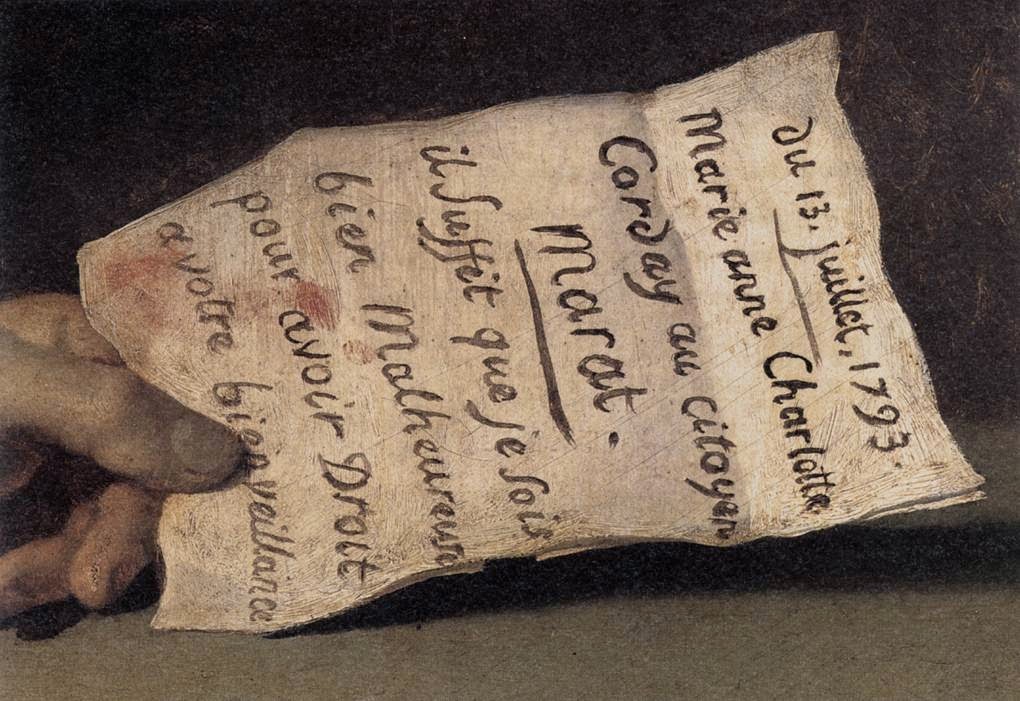.jpg)

